LES BATAILLES D’AZNAVOUR ET LE COMBAT DE SOULEYMANE
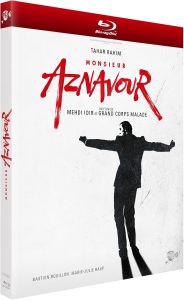 MONSIEUR AZNAVOUR
MONSIEUR AZNAVOUR
Ah, il en a pris pour son compte, le jeune Charles Aznavour ! Rastaquouère, nabot, Juif, infirme à la voix cassée et nasillarde. Un journaliste écrit : « Les Arméniens sont bons pour compter les sous. M. Aznavour devrait se lancer dans la comptabilité… » Face à ces critiques qui tiennent clairement de l’insulte, le chanteur fait le dos rond, convaincu qu’il aura un jour son nom en haut de l’affiche mais aussi que, seul, un travail acharné lui permettra de percer et de concrétiser son rêve. Ce sont les pages d’un livre d’histoire(s) que tournent Medhi Idir et Grand Corps Malade. Le livre de la vie de Charles Aznavour (1924-2018) dont les chapitres portent les titres de chansons de légende comme Je m’voyais déjà, La bohème ou Emmenez-moi. Autant dire que les fans du chanteur s’y retrouveront sans peine. Et que d’aucuns fredonneront probablement devant leur Blu-ray. Tout commence pendant la guerre lorsque la famille Aznavourian peine à joindre les deux bouts, sans perdre pour autant une joie de vivre profondément ancrée dans l’âme de Micha, le père, de Knar la mère ou d’Aïda, la grande sœur qui couve le petit Charles. Les premières séquences de Monsieur Aznavour mixent ces scènes de liesse familiale, de fête permanente où la joie doit damer le pion à la misère tandis que se déroulent les images d’archives du dramatique exil arménien, une origine qui hantera toujours le chanteur et fera de lui un militant actif de cette cause. En brossant de bons portraits de Pierre Roche, le partenaire des débuts ou d’Edith Piaf, la « grande soeur », le film s’attache à montrer combien, porté par sa passion et élevé par ses parents dans une atmosphère de musique et de théâtre, Charles Aznavour ne cessera de se battre avec une absolue ténacité. Dans le milieu de la chanson, peu d’artistes ont réussi à percer et à convaincre sans coup férir. Mais on a, ici, le sentiment que les obstacles ont été encore plus nombreux sur le chemin d’Aznavour. Et l’émotion étreint le spectateur quand, ce soir de décembre 1960, le chanteur, après avoir interprété Je m’voyais déjà et son fameux complet bleu « qui était du dernier cri » devant « ce Tout-Paris qui nous fait si peur », se tient derrière le rideau de l’Alhambra. Il est sûr que sa carrière est finie. On le pousse à aller saluer. Il revient dans la lumière. Le public l’applaudit à tout rompre. Aznavour est né. Pour incarner le chanteur, Medhi Idir et Grand Corps Malade ont trouvé en Tahar Rahim (né au cinéma dans Un prophète de Jacques Audiard en 2009) un interprète époustouflant qui a réussi à se fondre dans le personnage sans jamais imiter le grand Charles mais en jouant la ressemblance sans tomber dans le masque. Fils d’immigrés et d’apatrides, Aznavour est devenu l’un des symboles de la culture française, un « ambassadeur de la chanson française à travers le monde ». Un monument, en somme ! Que le film parvient, avec aisance, à nous rendre proche et humain. (Pathé)
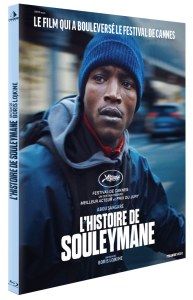 L’HISTOIRE DE SOULEYMANE
L’HISTOIRE DE SOULEYMANE
Tandis qu’il pédale dans les rues de Paris pour livrer des repas, Souleymane répète inlassablement son histoire. Dans deux jours, il a rendez-vous dans les locaux de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour passer son entretien de demande d’asile, le sésame pour obtenir des papiers. Mais Souleymane n’est pas prêt. Révélation de la dernière sélection Un Certain Regard à Cannes où il a obtenu le prix du jury et le prix d’interprétation masculine pour Abou Sangare, L’histoire de Souleymane est le troisième long-métrage de Boris Lojkine après Hope (2014) qui racontait l’histoire de Léonard et de Hope, un Camerounais et une Nigériane qui se rencontrent sur leur chemin vers l’Europe puis Camille (2019) centré sur la vie de la photo-reporter Camille Lepage, durant la guerre civile de République centrafricaine de 2013-2014 où elle perdra la vie. « Depuis quelques années, dit le cinéaste, j’avais envie de réaliser un film sur ces livreurs à vélo qui sillonnent la ville avec leurs sacs bleu turquoise ou jaune vif, siglés de l’application pour laquelle ils travaillent, tellement visibles et pourtant totalement clandestins – la plupart sont sans- papiers. » Autour de la figure omniprésente de Souleymane, dont l’existence est fortement compressée par trois exigences : «gagner de quoi manger, s’assurer un toit pour dormir, préparer son entretien de demande d’asile», le film montre Paris comme une ville étrangère dont on ne connaîtrait pas les codes, où chaque policier est une menace, où les habitants sont hostiles, pleins de morgue, difficiles d’accès… Des HLM de grande banlieue aux immeubles haussmanniens du centre, des MacDo aux immeubles de bureau, des centres d’hébergement d’urgence aux wagons de RER, Lojkine montre Paris sous un angle radicalement différent. « L’autre dans le film, dit-il, c’est nous : le travailleur pressé qui commande son burger, le passant bousculé qui peste contre les livreurs à vélo, la fonctionnaire qui se tient face à Souleymane… » En s’appuyant sur un époustouflant comédien non-professionnel (dans les suppléments, on peut voir les nombreux essais réalisés par Abou Sangare qui, dans la vie, est mécanicien), L’histoire de Souleymane apparaît comme un film haletant. Parce qu’il suit au plus près un livreur constamment en mouvement, le tout dans une mise en scène qui supprime tout ce qui ne relève justement pas de ce mouvement permanent qu’est la vie de Souleymane. Stressant aussi parce que l’existence de ce livreur aux prises avec un système sans pitié est suspendue à la décision de l’OFPRA et d’une fonctionnaire anonyme (Nina Meurisse, déjà présente dans Camille). Souleymane a acheté un récit factice selon lequel il serait un opposant politique membre de l’ Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). Après les trépidantes 48 heures dans la vie de Souleymane, presque toujours filmées à l’arrache dans les rues de Paris, l’entretien à l’OFPRA, dans un cadre soudain rigide, est presque un film dans le film. « Je voulais, souligne encore le réalisateur, que cet entretien soit comme un duel, où jusqu’au bout Souleymane se batte bec et ongles, et que le spectateur épouse sa cause, jusqu’au moment où tout se renverse ». Lorsqu’à la fin Souleymane raconte enfin pourquoi et comment il a quitté la Guinée, il a peut-être tout perdu, mais au moins, pour la première fois, il a parlé en vérité. Il est redevenu lui-même. Une œuvre bouleversante et magnifique ! (Pyramide)
 TROIS AMIES
TROIS AMIES
En voix of, Victor plante le décor. Voici des rues et des places, des façades et des parcs de Lyon, voici enfin le couloir d’un lycée, celui où Joan, la femme de Victor, enseigne l’anglais. A Alice, sa meilleure amie, prof comme elle, Joan confie, en s’effondrant, qu’elle n’est plus amoureuse de Victor. Pire, elle souffre de se sentir malhonnête avec lui qui l’adule tant. Mais Alice la rassure : elle-même n’éprouve aucune passion pour Eric et pourtant leur couple se porte à merveille… Ce qu’Alice ignore, c’est qu’Eric entretient une liaison secrète avec Rebecca, leur amie commune… Lorsque, finalement, Joan décide de quitter Victor, l’existence des trois amies est largement bouleversée. D’autant que Victor disparaît dans un accident de la circulation… Avec Trois amies, son douzième long-métrage, Emmanuel Mouret poursuit dans cette veine qui lui est chère, celle qui traite de l’art d’aimer et de toutes ses nombreuses variations. Mais là où l’on pouvait s’attendre au ton enjoué et allègre qui caractérise ses films précédents, le réalisateur marseillais adopte une gravité mâtinée de mélancolie pour évoquer, une nouvelle fois, l’amour et le hasard. Avec ses accents de mélodrame, voici une comédie dramatique dans le sens où le comique et le tragique y sont enlacés tout du long. Joan est sentimentale et raisonnable mais en souffrance, Alice joue la carte de la sécurité mais se laisse aller à rêver lors de longs appels téléphoniques avec Stéphane, un peintre de renom. Quant à Rebecca, sa générosité en amour lui joue des tours « inamicaux ». Ces personnages n’ont rien de héros. Ils sont affectés, peuvent être égoïstes, capricieux, réagissent parfois avec maladresse, mais sont aussi capables de considération, de scrupules. Et tous se posent la même question : comment font les autres ? Ils sont parfois beaux, parfois un peu ridicules mais ne se retournent jamais contre les autres. Avec pudeur et délicatesse, un poil d’irrationnel et toujours une étonnante musicalité, Mouret construit une narration complexe qui donne un peu l’impression d’une histoire sans fin dont on a toujours envie de connaître la suite. D’autant que les comédiennes, India Hair (Joan), Camille Cottin (Alice) et Sara Forestier (Rebecca) sont en verve ! Les hommes (Damien Bonnard, Grégoire Ludig, Vincent Macaigne et Eric Caravaca) tentent de suivre le rythme dans les arcanes féminines de l’art d’aimer. (Pyramide)
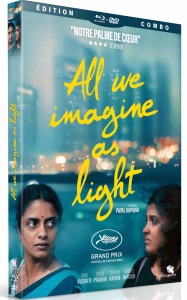 ALL WE IMAGINE AS LIGHT
ALL WE IMAGINE AS LIGHT
Sans nouvelles depuis des années de son mari parti travailler en Allemagne, Prabha, infirmière à Mumbai, ancrée dans les traditions, s’interdit toute vie sentimentale même si Manoj, un timide médecin échographiste tente de la courtiser en lui écrivant des poèmes. Un jour, cette femme grave et tourmentée reçoit de la part de son mari un autocuiseur à riz. De son côté, Anu, sa colocataire, plus jeune, plus moderne, plus enjouée, fréquente en cachette Shiaz, un jeune homme musulman qu’elle n’a pas le droit d’aimer mais qu’elle retrouve dans des endroits isolés de la ville. Lors d’un séjour dans un village côtier, ces deux femmes empêchées dans leurs désirs entrevoient enfin la promesse d’une liberté nouvelle. Chronique des travailleurs nocturnes à Mumbai (l’ancienne Bombay), le film s’attache plus particulièrement aux portraits intimes de trois femmes : Prabha et Anu, les deux infirmières colocataires mais aussi Parvaty, une cuisinière qui travaille également dans le même hôpital. Veuve, Parvaty est en attente d’expulsion de son logement, qui doit être démoli, mais elle ne parvient pas à prouver son droit à être relogée ou obtenir une compensation, car son défunt mari ne lui a laissé aucun document. Prabha va l’aider dans ses démarches… Après avoir mis en scène, en 2021, Toute une nuit sans savoir (2021), mélange assez politique d’histoire d’amour et de révolte étudiante, la cinéaste indienne Payal Kapadia signe ici All We Imagine as Light présenté en compétition officielle à Cannes 2024 où il a remporté le Grand prix. Cette chronique de trois femmes d’âges et de conditions différentes semble, de prime abord, moins politique mais la cinéaste précise : « Je pense que tout est fondamentalement politique. L’amour, en Inde, c’est une affaire extrêmement politique. Je ne dirais donc pas que ce film-ci n’est pas politique. Savoir qui on peut épouser est une chose très complexe en Inde. La caste et la religion, entre autres choses, ont une influence profonde sur le choix de la personne avec qui vous allez passer votre vie, ainsi que sur les conséquences de ce choix. L’amour impossible, qui compte parmi les thèmes principaux d’All We Imagine as Light, est une question très politique. » Le film s’appuie sur les décors de l’impressionnante et cosmopolite mégalopole indienne (le tournage a eu lieu dans un véritable hôpital… promis à la destruction), ses lumières, ses trains, ses bus, son métro, ses boutiques, ses sous-sols même et surtout tous ceux qui viennent de tout le pays pour y travailler. La cinéaste s’intéresse aussi au boom immobilier et à la vitesse à laquelle la ville se transforme dans une sorte d’étrange gentrification. Ce film immergé dans la ville s’ouvre, vers la fin, lorsque et Anu et Prabha vont au bord de la mer. Le propos ressemble alors à un conte de fées ou un long rêve qui permet à Prabha d’exprimer les choses qu’elle veut dire à son mari ou lui entendre dire. Enfin, les trois comédiennes Kani Kusruti (Prabha), Divya Prabha (Anu) et Chhaya Kadam (Parvaty) offrent une interprétation remarquable. (Condor)
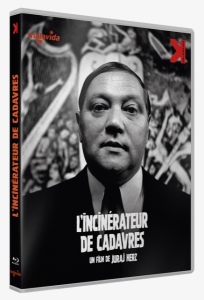 L’INCINERATEUR DE CADAVRES
L’INCINERATEUR DE CADAVRES
Dans la Tchécoslovaquie de 1938, M. Kopfrkingl travaille dans un crématorium. Plus qu’un métier, il voit dans l’incinération des cadavres la beauté, la transcendance, un salut pour l’humanité. Ce type peu avare de sa personne croise un jour un ancien compagnon d’armes, sympathisant nazi, qui lui suggère que du sang allemand coule dans ses veines. Alors que les Allemands envahissent le pays, Kopfrkingl, trouvant l’opportunité de montrer son savoir-faire et de perfectionner ses compétences, va se prendre à rêver d’une race pure, à commencer dans sa propre famille. Son crématoire va pouvoir tourner à plein régime. Peut-être parce qu’il a oeuvré dans le domaine des marionnettes, au côté du maître Jan Svabkmajer, le réalisateur slovaque Juraj Herz (1934-2018) a été boudé par les cinéastes de la Nouvelle vague tchèque. Il a cependant donné une suite de films marquants. En 1968, en adaptant un récit de Ladislav Fuks, Herz réalise, avec L’incinérateur de cadavres, son premier film pour lequel il a les mains entièrement libres. Cependant des scènes seront coupées et lorsque l’auteur et scénariste tombera en disgrâce, le film est censuré. Juraj Herz signe, ici, un grand film formaliste qui scrute le labyrinthe mental de son protagoniste principal en le filmant le plus souvent en gros plan, voire avec un objectif fish-eye. De ce fait, Kopfrkingl semble remplacer la réalité par ses propres désirs et fantasmes. Avec sa tête ronde qui lui donne l’air d’un bébé dans un corps d’adulte, le comédien Rudolf Hrusinsky incarne un esprit pervers et faible qui va se comporter comme un parfait rouage de la sinistre Solution finale. Le cinéaste a d’ailleurs eu à connaître de la machine nazie. En 1943, sa famille est déportée au camp de Ravensbrück, tandis que Juraj, âgé de 9 ans, est placé dans la partie russe du camp de Sachsenhausen. Avec sa fascinante mise en scène (le travail du directeur de la photo Stanislav Milota est somptueux) et aussi un montage brillant, L’incinérateur de cadavres prend la forme d’un puissante manifeste contre toutes les formes de totalitarisme. Présenté dans une belle édition (Blu-ray et DVD), le film est accompagné de multiples suppléments. Ainsi on découvre Brutalités récupérées (1965),le premier court métrage (32 mn) de Juraj Herz mais aussi This way to the cooking chambers, un documentaire de Daniel Bird (2017 – 22 mn). On trouve aussi des interviews de Juraj Herz, Stanislav Milota et Vlata Chramostova (2008 – 16mn), – Histoire, politique et nouvelle vague tchécoslovaque par Christian Paigneau réalisateur de Un conte de fées tchécoslovaques (2024 – 38mn) et Juraj Herz et l’incinérateur de cadavres, par Christian Paigneau et Garance Fromont chercheuse et enseignante en cinéma et spécialiste de la nouvelle vague tchécoslovaque. (2024 – 55 mn), enfin une analyse esthétique (10 mn) par Garance Fromont.(Potemkine – Malavida)
 ICHI THE KILLER
ICHI THE KILLER
Le chef d’un gang de yakuzas vient de disparaître sans laisser de trace, emportant avec lui une grosse somme d’argent. Persuadé que son patron s’est fait enlever par une bande rivale, son bras droit, Kakihara, va laisser libre court à ses instincts de psychopathe pour débusquer le coupable. Durant sa traque, le nom d’« Ichi » est sur toutes les lèvres. Mais qui se cache derrière ce tueur solitaire aux méthodes aussi abjectes que celles de Kakihara ? Dans un style outrancier où l’ultra-violence et l’insoutenable deviennent peu à peu jubilatoires, Takashi Miike (auteur de la trilogie Dead or Alive) réalise, en 2001, avec Ichi the Killer l’un de ses films les plus fous, les plus aboutis et les plus controversés. Adapté du manga culte éponyme de Hideo Yamamoto et porté par de nombreux acteurs de la scène contemporaine nippone, Ichi the Killer se fait fort de repousser les limites de la bienséance et du bon goût, valant à son prolifique réalisateur d’être affublé des étiquettes « violent, déjanté et provocateur ». Film de tous les excès, Ichi occupe une place à part dans l’oeuvre de Miike. La violence extrême fut initialement employée pour promouvoir le film : pendant la première internationale au Toronto International Film Festival en 2001, le public reçut, comme objets promotionnels, des sacs pour vomir incrustés du logo du film. Il est vrai qu’une scène de tuerie particulièrement extravagante présente un personnage qui tranche un homme en deux de la tête aux pieds, ainsi que le visage d’un autre homme, qui glisse le long d’un mur proche… Si le scénario ne brille pas par sa finesse, il faut reconnaître à Miike un sens certain du rythme, une invention graphique évidente, un goût pour le gore cartoonesque, une représentation très sombre de Tokyo et une absence de sobriété dans la mise en scène qui a dû faire se retourner Ozu dans sa tombe. Dans une nouvelle restauration, Ichi the Killer sort pour la première fois en 4K Ultra HD et Blu-ray. Une sortie accompagnée de nombreux suppléments dont trente minutes de making-of sur les coulisses des scènes culte ainsi que quatre entretiens avec le réalisateur Takashi Miike (33 mn), et les comédiens Alien Sun (15 mn), Tadanobu Asano (10 mn) et Shinya Tsukamoto (15 mn). Enfin Miike et la génération Manga (10 mn) est un extrait d’un documentaire réalisé par Yves Montmayeur en 2003, avec les témoignages de Takashi Miike, Shinya Tsukamoto et du réalisateur Alejandro Jodorowsky… (Carlotta)
 A SON IMAGE
A SON IMAGE
Une jeune femme shoote des photos de mariage sous le soleil au bord de la Méditerranée… Sur le chemin du retour, elle s’endort au volant de sa voiture. C’est l’accident mortel. Autour du corps de la jeune femme, ses proches, effondrés, se retrouvent… Avec A son image, sélectionné à la Quinzaine des cinéastes à Cannes 2024, Thierry de Peretti signe son quatrième long-métrage de fiction et propose une œuvre qui réunit les fragments de la brève mais riche existence d’Antonia, jeune photographe de Corse Matin à Ajaccio. Comédien et metteur en scène de théâtre, acteur au cinéma et donc cinéaste, Thierry de Peretti est natif d’Ajaccio et il fait, ici, son retour dans l’île de Beauté après s’être penché sur les arcanes de la police française dans Enquête sur un scandale d’État (2022). Déjà, en 2017, avec Une vie violente, il évoquait l’histoire du Bastiais Stéphane qui retourne en Corse pour assister à l’enterrement de son ami d’enfance Christophe, compagnon autonomiste assassiné la veille. Stéphane se rappelle alors l’enchaînement des événements qui ont fait de lui un nationaliste radical, puis un clandestin. En adaptant le roman éponyme de Jérôme Ferrari, paru chez Actes Sud en 2018, le cinéaste va détailler, de la fin des années 70 aux années 90, le parcours d’Antonia, son engagement, ses amis, ses amours qui se mêlent intimement aux grands événements de l’histoire politique de l’île jusqu’à l’aube du 21esiècle. La vie d’Antonia est très vite placée sous le signe de son amour fulgurant pour Pascal (Louis Starace), militant nationaliste dont l’engagement lui vaudra différents séjours en prison et feront d’Antonia ou la réduiront à être « la femme de Pascal ». Car, dans cette fresque d’une génération, Antonia, tout en étant reporter-photographe et donc témoin, est aussi impliquée dans la confrontation entre le combat des indépendantistes et le pouvoir central parisien. Elle vit au plus proche les incarcérations de son amant, les risques pour sa vie mais aussi les événements (ah, les fameuses conférences de presse des membres cagoulés du FNLC!) qu’elle couvre pour son journal. Mais Thierry de Peretti (qui incarne le prêtre et parrain d’Antonia) ne fait pas qu’un film politique. Il décrit des destinées intimes et s’interroge aussi sur la question de l’image et de son contenu. Photographe de presse, est-ce un métier honorable, se demande Antonia lorsqu’elle bataille, dans le bureau de son patron à Corse Matin, pour aller à Lyon couvrir un procès concernant les luttes nationalistes. Son chef lui répond proximité, fait-divers locaux, nécrologies et fêtes de village… Alors, pour se confronter à l’Histoire, à la guerre et à l’image, Antonia partira suivre, du côté de Vukovar, le début du conflit yougoslave. Porté par la figure d’Antonia (excellente Clara-Maria Laredo), A son image est une œuvre âpre et attachante qui questionne, avec finesse, l’innocence et l’absence de pitié. (Pyramide)
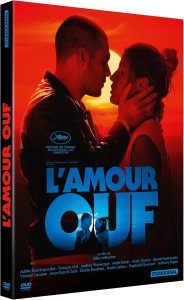 L’AMOUR OUF
L’AMOUR OUF
Quelque part du côté des cités du nord de la France, dans les années 1980, Clotaire, petit loubard, perdu dans les difficultés du monde ouvrier, traîne avec sa bande de copains. Un jour, sortant d’un bus scolaire, il aperçoit Jacqueline, récemment orpheline de sa mère et très proche de son père, une bonne élève sérieuse. Clotaire s’emballe et Jacqueline n’est pas insensible à son côté rebelle à belle petite gueule. Lorsque Clotaire lance : « Je t’appellerai Jackie ! », la jeune fille répond : « Moi, je ne t’appellerai pas… » Pourtant, ces deux-là vont tomber follement amoureux et vivre une passion dévorante, malgré des différences de condition sociales et d’aspirations personnelles. Dans les années 1990, après avoir passé dix années en prison pour un crime qu’il n’a pas commis, Clotaire est toujours hanté par Jackie et tente désespérément de la revoir. Mais Jackie est désormais mariée, installée dans une nouvelle vie rangée, et semble avoir définitivement tourné le dos à leur passé. Mais en réalité, aucun des deux n’a oublié cet amour qui les a consumés adolescents et qui pourrait bien ressurgir et bouleverser à nouveau leurs vies. Second long-métrage (en solo) de Gilles Lellouche après Le grand bain (2018), comédie dramatique sur sept hommes cabossés par la vie et qui reprennent espoir en s’investissant dans la natation synchronisée, L’amour ouf est une belle réussite vue par 4,2 millions de spectateurs en France. C’est aussi un film « générationnel » qui accroche un public de jeunes filles et femmes. Sans doute emballées par les punchlines du Clotaire de 17 ans et (surtout?) par le charme canaille de Malik Frikah, jeune comédien qui décroche, ici, son premier grand rôle de cinéma. Comme Mallory Wanecque est une Jackie très à son aise aussi, ces deux jeunes acteurs dament quasiment le pion aux deux stars du film, en l’occurrence François Civil et Adèle Exarchopoulos à l’âge adulte. Le duo est entouré de visages connus du cinéma français : Alain Chabat, Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste, Jean-Pascal Zadi, Elodie Bouchez, Karim Leklou, Raphaël Quenard et Anthony Bajon. Un beau casting ! Présenté en compétition officielle au dernier festival de Cannes (où l’accueil n’a pas été très chaleureux), L’amour ouf, adaptation du roman éponyme de l’auteur irlandais Neville Thompson, publié en 2000, est un projet que Lellouche porte depuis longtemps et qu’il décrit comme « une comédie romantique ultra-violente ». En citant des références qui vont de West Side Story (le film contient de bonnes séquences chorégraphiées) aux œuvres de Scorsese et Tarantino, Lellouche a imaginé, dit-il, « un doux mélange entre violence et sentiments exacerbés, entre chaud et froid, entre sucré et âpre ». Au total, le film apparaît comme un patchwork, pas forcément indigeste, de polar musclé et de drame romantique. (Studiocanal)
 SEPTEMBRE SANS ATTENDRE
SEPTEMBRE SANS ATTENDRE
Après quinze années de vie commune, Ale et Alex ont une idée un peu folle : organiser une fête pour célébrer leur séparation. Si cette annonce laisse leurs proches perplexes, le couple semble certain de sa décision. Mais l’est-il vraiment ? Huitième film de fiction du réalisateur espagnol Jonas Trueba, Septembre sans attendre (Volveréis en v.o.) met en scène un couple interprété par Itsaso Arana (Ale) et Vito Sanz (Alex) également co-scénaristes du film et déjà ensemble à l’écran pour Eva en août (2020) et Venez voir (2022) du même réalisateur. Cette comédie dramatique repose sur une idée répétée de manière littérale tout au long du film. Quasiment jusqu’à épuisement ! Pourtant, le motif de la séparation n’est jamais clairement exprimé. « Pour moi, dit Trueba, c’est important qu’il n’y ait pas de raison concrète, que cela soit presque un mystère, pour éviter que le film devienne trop réaliste. Habituellement, les films sur des couples et des ruptures contiennent un drame évident : les enfants, une infidélité… Pas ici. Je voulais vider le film de tout élément commun, reconnaissable ; qu’il reste éthéré. Ce qui le fait résonner avec les comédies romantiques classiques. » Le cinéaste cite ainsi Cette sacrée vérité (1937) de Leo McCarey. Dès la première séquence, le couple interprété par Cary Grant et Irene Dune annonce : « Nous allons nous séparer ». Chacun soupçonne l’autre de l’avoir trompé mais, en réalité, cela n’a pas d’importance. L’enjeu c’est la nécessité de se défier l’un l’autre avec cette idée de séparation, car ils savent sûrement que c’est la seule manière de se pardonner et d’éprouver à nouveau leur amour. Le rythme de Septembre sans attendre repose sur l’annonce répétée de cette drôle d’idée, célébrer les séparations plutôt que les unions. Le couple répète sans cesse la même annonce, presque toujours avec les mêmes mots. La variation se trouve dans les réactions de ceux qui les écoutent. Et chez Ale et Alex aussi, de manière subtile, à mesure qu’ils perdent leur certitude sur ce qu’ils disent. Enfin Septembre… opère une mise en abyme. On découvre que ce film est aussi le film qu’Ale est en train de terminer. Du coup, le travail de montage s’inscrit dans un jeu avec le spectateur. Le film est ainsi truffé de petits jeux de montage qui sont comme des expérimentations : le split-screen, la transition au volet, les changements d’axes… Ces marques apparaissent à partir du moment où l’on comprend que le personnage d’Ale est en train de monter le même film que celui que le spectateur voit. Une manière de dire comme nos vies et les films s’entremêlent. Une belle chronique désenchantée mais drôle. (Arizona Distribution)
 MEGALOPOLIS
MEGALOPOLIS
À New Rome, allégorie de New York, une jeune femme, Julia Cicero, est partagée entre la loyauté envers son père Franklyn Cicero, le maire de la ville, et son amant, l’architecte Cesar, artiste de génie ayant le pouvoir d’arrêter le temps. Si le premier a une vision archi-conservatrice de la société, Cesar est plus progressiste et tourné vers l’avenir. Après une catastrophe qui a ravagé la ville, l’architecte veut recréer la cité et en faire une utopie, alors que le maire, cupide et corrompu, y est totalement opposé… Megalopolis est un projet de longue date du réalisateur (l’écriture du film a débuté dans les années 80), qu’il rêvait de concrétiser depuis plusieurs décennies. Après plusieurs échecs pour y aboutir, Coppola décide de risquer l’endettement en investissant une grande partie de sa fortune personnelle dans le budget, estimé entre 100 et 120 millions de dollars. Afin de donner vie à son probable ultime film, il s’entoure également d’une distribution de luxe, constituée de jeunes acteurs du moment, tels qu’Adam Driver (qui incarne Cesar Catalina, l’architecte) ou Shia LaBeouf, des vétérans du cinéma américain, que ce soit Jon Voight, Dustin Hoffman ou Laurence Fishburne et des proches de son entourage comme sa sœur Talia Shire et son neveu Jason Schwartzman. Prononcer le nom de Francis Ford Coppola, c’est faire résonner, dans nos mémoires, le souvenir de la trilogie des Parrain (1972-1990), de Conversation secrète (1974), de Rusty James (1983), de Cotton Club (1984), du mélancolique Peggy Sue s’est mariée (1986) et évidemment de ce monument du film de guerre qu’est Apocalypse Now (1979). Excusez du peu ! A Cannes, l’an dernier, où il était en compétition officielle (50 ans après sa palme pour le formidable Conversation secrète et 45 ans après celle d’Apocalypse!), le vétéran américain (85 ans) s’est fait méchamment étrillé par la critique. On en passe des vertes et des pas mûres sur ce drôle d’objet cinématographique qui confronte les créateurs et les bureaucrates. Sans aucune allusion à une situation politique contemporaine ? Faut-il se risquer à voir Megalopolis ? Oui, si on ne craint pas un délire kitsch et futuriste pour s’offrir quelques instants flamboyants… (Le Pacte)
 TRANSFORMERS : LE COMMENCEMENT
TRANSFORMERS : LE COMMENCEMENT
Dans la cité d’Iacon, Orion Pax et D-16, deux mineurs d’Energon, vont découvrir une piste quant à la disparition de la Matrice du Commandement. Leur quête de l’artéfact va les mener à la surface de leur planète, Cybertron, accompagnés de B-127 et d’Elita-1. Ce qu’ils ignorent, c’est que cette aventure les mènera à devenir respectivement Optimus Prime et Mégatron, deux frères d’armes qui passés ennemis jurés, vont mener au plus grand des combats entre les Autobots (faction de Transformers qui représentent le Bien) et les Decepticons qui tentent d’imposer la force, la puissance et la domination des Transformers dans l’univers par tous les moyens en combattant les Autobots. Réalisé par Josh Cooley, ce film d’animation 3D est une préquelle à la franchise Transformers créée par les entreprises japonaise Takara Tomy et américaine Hasbro, toutes deux productrices de jouets. La franchise commença avec une ligne de jouets constituée de robots pouvant être transformés en véhicules. Ces robots constituent deux groupes, les Autobots et les Decepticons, qui se combattent. Par la suite la franchise a été la source de comics, de dessins animés, de jeux vidéo et de films. Mêlant action et science fiction, ces derniers se comptent, à ce jour, au nombre de huit, le premier datant de 2007, réalisé par Michael Bay et produit par Steven Spielberg. Avec une réflexion pas malvenue sur le pouvoir, voici un blockbuster familial qui ne révolutionne pas le genre mais qui fait bien le job. (Paramount)
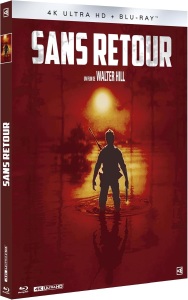 SANS RETOUR
SANS RETOUR
En 1973, neuf membres de la Garde nationale de Louisiane participent à un banal exercice militaire dans un bayou au coeur d’une forêt épaisse et touffue en territoire cajun. Pressés de finir au plus vite cet exercice, dont le sens leur échappe, ils volent des barques aux autochtones afin d’accéder plus rapidement au point de ralliement. Intrigués par cette incursion et par la prise de leur matériel, les habitants des marais se manifestent, alors que les militaires ont déjà commencé à quitter le rivage à bord des embarcations. Crawford Poole, le plus haut gradé, décide de retourner sur la rive, pour y restituer les barques. Mais, l’un de ses hommess tire alors une rafale de balles à blanc, par simple provocation. Cet acte est malheureusement pris très au sérieux par les Cadiens qui ripostent aussitôt avec de vraies balles. Poole est tué sur le coup. Pour les neuf autres membres de la garde nationale, c’est le début d’une lutte acharnée pour survivre dans des marécages qu’ils ne connaissent pas et avec peu de moyens de se défendre. Réalisateur de seconde équipe pour Norman Jewison et Peter Yates, respectivement sur L’affaire Thomas Crown (1968) et Bullitt (1968), scénariste pour Guet-apens (1972) de Sam Peckinpah et Le piège (1973) de John Huston, le vétéran Walter Hill a ensuite connu une solide carrière de réalisateur avec des films comme Les guerriers de la nuit (1979) ou 48 heures (1982). Plutôt mal accueilli aux USA mais avec de bonnes critiques dans le reste du monde, Southern Comfort (titre original), réalisé en 1981, est pourtant un bon huis-clos dans les décors hostiles et oppressants (le tournage a été difficile) d’un bayou. Pour les gardes nationaux (incarnés par des comédiens encore peu connus à l’époque mais excellents comme Keith Carradine, Powers Boothe ou Fred Ward), tout devient vite une angoissante question de survie. Sur une musique de Ry Cooder, du bon cinéma d’action brutal et efficace. (L’Atelier d’images)
 ANGELO DANS LA FORET MYSTERIEUSE
ANGELO DANS LA FORET MYSTERIEUSE
Angelo, 10 ans, se rêve aventurier et explorateur. Jusqu’au jour où, partant en voiture avec sa famille pour se rendre au chevet de sa chère grand-mère bien malade, il est brusquement mis au défi de prouver son courage… Oublié par erreur sur une aire d’autoroute, Angelo décide de couper à travers la forêt pour rejoindre la maison de Mémé. Il s’enfonce alors dans un territoire mystérieux peuplé d’êtres étranges que menace un ennemi pire encore que l’ogre de la région… Au départ du film d’animation réalisé en France par Vincent Paronnaud (déjà co-auteur avec Marjane Satrapi de Persepolis en 2007 et Poulet aux prunes en 2011) et Alexis Ducord, il y a la bande dessinée Dans la forêt sombre et mystérieuse du même Vincent Paronnaud parue en 2016. Dans une belle adaptation, l’intrigue se concentre sur un gamin à l’imagination débordante, qui va être amené à pénétrer dans une forêt peuplée d’êtres aussi excentriques que mystérieux. Très vite, pour le gamin aux grandes lunettes carrées, l’aventure va devenir une exploration inédite et inoubliable. Avec un petit côté Alice au pays des merveilles, le film réussit à capter l’attention des petits (comme des grands) à travers une histoire bourrée de rebondissements autant que de personnages étranges, attachants et drôles. Retenons ainsi Fabrice, l’écureuil qui rêve de devenir un oiseau et qui s’exprime avec la voix si reconnaissable de Philipe Katerine. Quant à Angelo, il n’est pas avare en commentaires et en vannes dignes de son jeune âge. Enfin, du point de vue visuel, Angelo est une réussite par sa maîtrise de différentes formes d’animation. Comme quoi, l’animation française existe et elle a de vraies qualités! (Le Pacte)
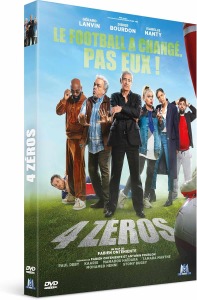 QUATRE ZEROS
QUATRE ZEROS
Si l’on fait exception de Coup de tête (1979) de Jean-Jacques Annaud ou Looking for Eric (2009) de Ken Loach, les films de fiction, notablement bons, sur le football ne sont pas légion. Alors que Mercato sort sur les grands écrans, voici les aventures de Sylvie Colonna, José Pinto (Didier Bourdon) et leur fils Manu lancés dans le foot-business. Là où Mercato est un thriller, Quatre zéros est une comédie qui n’a pas la prétention, du moins on l’imagine, de s’aligner dans la Ligue des champions. En 2002, Fabien Onteniente, qui n’était pas encore l’heureux auteur de Camping (oui, le film avec Jacky Pic et Patrick Chirac) donnait Trois zéros, une histoire de jeune Hongrois, prodige du ballon rond… Gérard Lanvin y tenait déjà le rôle d’Alain Colonna, agent de joueur. On retrouve le même Alain Colonna, désormais paisible retraité du côté de Tahiti. Or voilà que Sylvie (Isabelle Nanty), la sœur d’Alain, lui demande un coup de main. Car Manu, qui se rêve agent de joueur, a découvert, lors d’un défi de la lucarne, le jeune mais talentueux Kidane (Mamadou Haïdara). Le problème, c’est que Manu n’est pas vraiment une lumière. L’autre problème, c’est que les affaires vont mal. La survie du Churrasco, le restaurant portugais du couple, ne tient qu’à un fil. Alors les Pinto voient en Kidane l’occasion de sortir de la galère. Alain revient donc mais le football a changé… Tous ensemble, ils vont devoir affronter DZ, l’agent le plus influent du métier, un homme au bras long et à la mauvaise réputation… Avec comme objectif de permettre à Kidane d’intégrer le club de ses rêves : le PSG. Alors que l’on voit passer là des guests comme Paul Pogba, Rai, Guy Roux ou Rolland Courbis, il faut se rendre à l’évidence, cette satire des dérives du foot-business est une entreprise modeste. Pas méchante, pas passionnante non plus. (M6)

