DANS LES PAS DE LA TRAGIQUE GELSOMINA
 LA STRADA
LA STRADA
« Gelsomina, tu te souviens de Zampano. Il avait emmené Rosa. Pauvre Rosa ! Je ne verrai même pas sa tombe ! Elle est morte, ma pauvre fille ! Elle était si belle, si gentille… Elle savait tout faire. Regardez Zampano, comme elle lui ressemble. C’est Gelsomina. On est tellement malheureux ! Je vous l’ai déjà dit : elle n’est pas comme Rosa. C’est une bonne petite, elle fait tout ce qu’on lui demande, mais elle a poussé drôlement. Si elle mange tous les jours, peut-être qu’elle changera. Tu veux aller avec lui à la place de Rosa ? Il t’apprendra un métier, tu gagneras des sous, ça nous fera une bouche de moins à nourrir. Il est bon, tu sais, il te traitera bien… » C’est la mère de Gelsomina qui « invite » celle-ci à rejoindre Zampano… Costaud fruste et forain ambulant, Zampano achète, de fait, la gentille Gelsomina à sa mère pour le seconder dans son grand numéro de briseur de chaînes. Le reste du temps, il la traite comme bonne à tout faire sans lui accorder plus d’attention. Un jour, lors de leur périple forain, Gelsomina est fascinée par le « Fou » (Richard Basehart) et par son dangereux numéro de funambule. Mais Zampano est en conflit avec le « Fou ». De plus, l’intérêt qu’il porte à Gelsomina l’agace. Après une bagarre qui vaut quelques jours de prison à Zampano, les deux s’affrontent dans une rixe où le « Fou » perdra la vie. Choquée, Gelsomina bascule dans la folie et, puisqu’elle ne peut plus jouer son rôle, Zampano finit par l’abandonner… Après une petite poignée de films, le grand succès international vient en 1954 pour Federico Fellini avec La strada. L’idée du film est née vers 1952, alors que Fellini se débattait avec le montage du Cheik blanc. Pour des raisons de production, le maestro retarda le projet et tourna Les vitelloni (1953). Autour du thème récurrent, dans son cinéma, du monde du spectacle et notamment du cirque, Federico Fellini donne un œuvre qui prend ses racines dans le néo-réalisme italien, ce courant qui met en scène des personnages issus de milieux modestes dans un pays dévasté par la guerre. En suivant de village en village ses deux saltimbanques, Fellini ajoute ici une touche de poésie et d’onirisme. Au côté d’un Anthony Quinn qui obtient, dans le cinéma transalpin, l’un des rôles les plus mythiques de sa carrière, la figure la plus bouleversante de La strada (qui sort dans une superbe restauration en 4K, réalisée par Criterion), c’est évidemment cette Gelsomina pleine d’espoir, d’innocence, de naïveté et de grâce « chaplinesque » à laquelle Giulietta Masina, épouse de Fellini depuis 1943, apporte sa tendre lumière. Son visage est d’une expressivité intense, chaque mimique donnant un effet clownesque, et son sourire mélancolique reste longtemps à l’esprit d’autant que ce voyage des comédiens s’avère être un chemin de croix. Le film obtiendra le Lion d’argent à la Mostra de Venise 1954 et l’Oscar du meilleur film en langue étrangère 1957. L’édition inclut le documentaire Fellini, je suis un grand menteur (2002), un formidable portrait du maestro dans lequel le réalisateur révèle les clefs de son cinéma, agrémenté de nombreux extraits de films, d’archives et de témoignages. Une fable humaine et lyrique. Un pur chef d’oeuvre ! (Rimini Editions)
 UN OURS DANS LE JURA
UN OURS DANS LE JURA
En mâchant distraitement un bout de pain, Michel roule paisiblement au volant de son pick-up sur une route déserte. Soudain, à la vue d’un ours sur la chaussée, il fait une embardée, tente de reprendre le contrôle de son véhicule et finit par percuter une grosse limousine en stationnement. Le choc tue net une blonde qui faisait pipi entre les portières. Quant au conducteur, parti se soulager, il finira empalé sur une branche de sapin. Abasourdi, Michel revient dans sa scierie, raconte son aventure à Cathy, son épouse. Ensemble, ils retournent sur le lieu de la collision. Dans le coffre de la voiture, le couple découvre un sac bourré de gros billets… Décidément le Jura a le vent en poupe dans le cinéma français. Après Vingt Dieux (voir c-dessous), Un ours dans le Jura retrouve, à son tour, les vastes espaces forestiers de la Franche Comté. Après deux premières réalisations bien reçues par la critique, Franck Dubosc donne dans le thriller rural qui lorgne, de façon assumée, du côté du Fargo (1996) des frères Coen. « Il n’y a pas d’ours dans le Jura » disent plusieurs personnages du film. Force est cependant de constater que c’est un imposant plantigrade qui met, ici, le feu aux poudres. Il met en effet en déroute une colonne de migrants qui s’avèrent être des mules transportant, dans leur estomac, de grosses quantités de drogue. Et surtout, en emplafonnant une limousine, Michel récupère l’argent de ce trafic illicite. A cause de ce brûlant pactole, le couple Michel-Cathy, usé par le temps et les difficultés financières, reprend des couleurs. L’argent ne fait pas le bonheur, on le sait. Mais il peut (largement) y contribuer. Et, dans cette histoire délibérément et joyeusement immorale, tout le monde va vite avoir envie d’en croquer. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ? Mais non ! dit Franck Dubosc. Dans la réalité, tout le monde n’est pas forcément beau ni gentil. Si Un ours dans le Jura peine parfois à trouver le juste ton entre le film noir, la saga rurale et la comédie déjantée, l’ensemble est porté par une belle galerie de personnages, tous soigneusement ciselés. Franck Dubosc s’est emparé du taiseux Michel face à une Cathy tonique à laquelle Laure Calamy apporte une vraie détermination. Les gros billets, elle sait parfaitement quoi en faire, quitte à devoir faire le nécessaire pour se débarrasser de cadavres évidemment encombrants. Autour de ce couple qui réapprend à se parler dans l’épreuve, on retrouve avec plaisir un Benoît Poelvoorde à son meilleur niveau en major de gendarmerie. Et puis aussi Joséphine de Meaux, Kim Higelin, Medhi Meskar ou Emmanuelle Devos, délicieusement tordue en patronne de club échangiste. Tous vont finir par goûter à l’interdit. Allègrement savoureux ! (Gaumont)
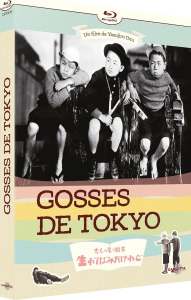 GOSSES DE TOKYO
GOSSES DE TOKYO
Une famille et leurs deux jeunes garçons, Keiji et Ryoichi, s’installent dans la banlieue de Tokyo. Les enfants, victimes de brimades de la part de la bande de gosses du quartier, font l’école buissonnière. Le père, mis au courant par l’instituteur, les force à retourner en classe afin qu’ils deviennent « des gens importants ». Les enfants, grâce à l’aide d’un garçon plus âgé, parviennent à se faire accepter et à remplacer l’ancien chef de la bande. Toutefois, ils se rendent compte que leur père, simple employé de bureau, fait quotidiennement des courbettes à son patron, quitte à se rendre ridicule. Il s’ensuit une dispute familiale orageuse. Les garçons ne comprennent pas les explications de leurs parents et décident de se rebeller en arrêtant de manger, « car si devenir quelqu’un d’important dans la société, comme le prêche le père, revient à faire des courbettes devant son chef, alors à quoi bon ? » En 1932, Yasujiro Ozu tourne Gosses de Tokyo qui est souvent considéré comme l’un de ses premiers grands succès. Alors que le cinéma parlant existe depuis la fin des années vingt, le cinéaste japonais met pourtant en scène un film muet en noir et blanc. Comme si le seul pouvoir des images était suffisant pour traduire cet univers où l’enfance se confronte au monde des adultes. Mêlant comédie, drame et critique sociale, cette œuvre filmée à hauteur d’homme, ici d’enfant (une position de caméra qui est la signature du maître nippon) dépeint la société japonaise des années 1930 à travers la perspective de deux jeunes frères découvrant le monde adulte. La mise en scène minimaliste et la simplicité des plans mettent en avant la subtilité des échanges familiaux et sociaux, tout en laissant transparaître une critique implicite de l’organisation sociale hiérarchique. A travers la malice de la mise en scène, qui capte avec un naturel déconcertant mimiques, rancœurs et petits plaisirs des deux enfants, se dessine une peinture de la société japonaise et de sa rigidité. Inédit en France en Blu-ray, Gosses de Tokyo sort dans une belle restauration 4K et est proposé avec un accompagnement musical du compositeur britannique Ed Hughes interprété par The New Music Players. Pour le plaisir, le coffret comprend aussi Bonjour (1959), le superbe remake en couleurs de Gosses de Tokyo. Enfin, dans les suppléments, on trouve Au nom du père (15 mn), un entretien inédit avec Pascal-Alex Vincent, cinéaste et enseignant à la Sorbonne Nouvelle, auteur, aux éditions de La Martinière, du livre Yasujiro Ozu : une affaire de famille. (Carlotta)
 VINGT DIEUX
VINGT DIEUX
Une fête campagnarde, de la musique, de la bière qui coule jusqu’au bout de la nuit. Totone est là avec ses copains Jean-Yves et Francis. Au bout de la soirée, Totone ramène une jeune fille sur sa mob. « C’est quoi, ton nom, déjà ? » demande-t-il avant de se retrouver sous les draps avec Aurore. Las, c’est la panne. Un autre soir, une autre fête. Totone se châtaigne avec des copains d’Aurore. Le père de Totone, malgré un coup dans le nez, repart en voiture. Et il finit tragiquement contre un arbre. La vie de Totone et de sa petite sœur Claire, 7 ans, bascule. Désormais, il faut survivre, trouver le moyen de gagner sa vie. Il se met alors en tête de fabriquer le meilleur Comté de la région, celui avec lequel il remporterait la médaille d’or du concours agricole et 30 000 euros. Premier long-métrage de Louise Courvoisier, Vingt Dieux plonge, avec Totone, dans l’univers des exploitations agricoles et des fruitières qui produisent le fameux Comté AOC. La cinéaste parle de son film comme d’« une épopée sentimentale et fromagère ancrée dans le village de son enfance. » C’est une sorte de western comtois en format Scope (les vastes paysages du Jura le méritent) que traverse une Totone qui n’a rien d’héroïque. Il serait même plutôt plein de défauts. Bagarreur quand il a un coup dans le nez mais aussi jeune chien fou quand il poursuit son rêve : produire un Comté au délicieux goût de fleur. Pour cela, il faut trouver un boulot qui consiste à nettoyer des chaudrons de cuivre et à se lever à 4h du matin pour faire, de ferme en ferme, la collecte du lait. Mais le désir, secret et sans doute inconscient, de rendre justice à son père disparu, va pousser Totone à franchir quelques lignes rouges. Alors on suit, avec un sourire, les aventures campagnardes de jeunes Pieds nickélés qui sont solidaires, sans trop se poser la question. Dans cette aventure qui n’a rien d’un documentaire sur le Comté, la cinéaste professe clairement de la tendresse pour des personnages que l’existence va amener à devenir adultes. Tous les comédiens du film sont des non-professionnels. Clément Favreau, interprète d’un Totone taiseux et fragile, travaille dans un élevage de volailles. Quant à Maïwène Barthélémy, qui était en BTS agricole quand elle a passé le casting, elle est Marie-Lise, une agricultrice franche, très capable, sûre d’elle à cette place, ce qui ne l’empêche pas d’être sexy. Après le film, on a envie de goûter à un très bon Comté. (Pyramide)
 HIVER A SOKCHO
HIVER A SOKCHO
Alors qu’il neige sur Sokcho, petite ville balnéaire de Corée du Sud, Soo-ha mène, comme tous les jours, sa petite vie routinière. Traversant le marché aux poissons où travaille sa mère, elle rejoint le Blue House, une modeste pension dans laquelle elle fait le ménage et la cuisine sous le regard bienveillant de M. Park, le propriétaire. Un jour, l’arrivée d’un Français, Yan Kerrand, va bouleverser la vie de Soo-ha. M. Park lui enjoint d’enfin utiliser la langue française qu’elle maîtrise bien mais qu’elle n’a pas l’occasion d’utiliser à Sokcho. Auteur réputé de romans graphiques, Kerrand n’est pas du genre bavard. Lorsque Soo-ha l’installe dans une chambre franchement minuscule de l’annexe de la pension, il lâche : « C’est intime ». Tandis que la présence de Kerrand réveille en elle des questions sur sa propre identité et sur son père français dont elle ne sait presque rien, la jeune femme va, doucement tisser un lien fragile avec l’auteur français. A cet homme qui dit aimer les lieux très fréquentés… lorsqu’ils sont désertés, elle va lui montrer la zone démilitarisée qui marque la séparation entre les deux Corée. Un jour, Soo-ha annonce à M. Park qu’elle va s’installer dans l’annexe. Par un petite fenêtre de sa chambrette, la jeune femme observe à la dérobé Kerrand (Roschdy Zem, taiseux et impeccable) à son plan de travail… Hiver à Sokcho est une œuvre d’une infinie délicatesse doublée d’une puissante mélancolie. Sans coup férir, le spectateur s’immerge dans une atmosphère d’autant plus particulière, ici, qu’elle est constamment hivernale. De cet univers gris-bleu d’une cité de bord de mer engourdie par le froid, le réalisateur franco-japonais Koya Kamura fait le décor d’une brève rencontre, d’une aventure probablement amoureuse qui demeure toujours en suspens. Kamura adapte, ici, le roman éponyme d’Elisa Shua Dusapin qui y questionnait ses origines françaises et coréennes et s’attache à la représentation du corps et, à travers lui, la thématique de la nourriture. On remarque en effet combien l’ensemble des personnages coréens sont préoccupés par la question de la chirurgie esthétique, un phénomène très répandu en Corée qui symptomatise la pression qu’il y a sur l’apparence. Chez les proches de Soo-ha (Bella Kim dans son premier rôle au cinéma), cela devient même une rengaine qui montre qu’on ne laissera jamais « la grande » tranquille sur l’image qu’elle renvoie. Dépourvu de lourdeurs, imprégné d’humanité, tout cela est bien beau et bien émouvant ! (Diaphana)
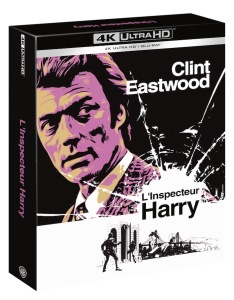 L’INSPECTEUR HARRY
L’INSPECTEUR HARRY
Alors qu’une jeune femme se baigne dans une piscine située sur un toit de San Francisco, un homme l’assassine à l’aide d’un fusil Springfield. Chargé de l’enquête, l’inspecteur de la police de San Francisco Harry Callahan retrouve une douille usagée sur un toit situé non loin du lieu du crime et un message d’un dénommé Scorpion. Le message réclame une rançon, faute de quoi le tueur en série abattra une personne par jour en commençant par « un prêtre catholique ou un nègre ». Callahan est un flic atypique. Son surnom de « Harry le charognard » (Dirty Harry en v.o.) est d’ailleurs une référence à sa réputation de se charger des affaires les plus « pourries ». Pour cette nouvelle affaire, il se voit imposer une jeune recrue, Chico Gonzalez, comme partenaire. Cela irrite Callahan qui considère qu’un policier d’expérience, tel que Frank DiGeorgio, est la seule personne dont il pourrait avoir besoin, arguant que ses partenaires finissent toujours blessés, voire pire. À la suite des menaces de Scorpion, toute la police de San Francisco est sur les dents. Un hélicoptère de la police parvient à déjouer sa seconde tentative de meurtre sur la personne d’un homme noir homosexuel, mais le tireur s’échappe et, le lendemain, réussit à tuer un jeune garçon noir en tirant d’un autre toit. La police lui tend alors un piège, près d’une église, sa prochaine victime devant être un prêtre catholique. Callahan et Chico, postés sur un toit en face de l’église, l’attendent et réussissent à l’empêcher d’accomplir son attentat. Malheureusement, Scorpion tue un policier dans sa fuite. Furieux que son plan macabre ait été mis à mal, Scorpion enlève une adolescente, la viole et l’enterre vivante dans un trou hermétiquement clos. Il contacte alors la ville et demande une rançon deux fois plus élevée que la précédente, joignant une dent de la victime à son message. Il précise qu’elle doit lui être versée rapidement car sa prisonnière dispose seulement d’assez d’air jusqu’au lendemain matin à 3 heures. Le maire décide de payer la rançon et Callahan doit en assurer la livraison. Premier volet en 1971 d’une saga qui comptera quatre suites, L’inspecteur Harry (présenté dans un coffret 4K Ultra HD) est mis en scène par Don Siegel. Clint Eastwood y endosse le personnage d’Harry Callahan qui lui vaudra une notoriété exceptionnelle et aussi une étiquette de « facho » décerné par une partie de la critique française. Le film sera un imposant succès critique et commercial et s’imposera comme un classique du polar dans lequel un flic solitaire flirte sans cesse avec la limite de la légalité pour attraper les criminels. Si Eastwood avait déjà travaillé avec Siegel dans Un shérif à New York (1969), Sierra torride (1970) et Les proies (1971), il n’était pourtant pas le premier choix de la Warner qui avait successivement proposé le rôle à John Wayne, Robert Mitchum, Steve McQueen, Burt Lancaster et Frank Sinatra. Par bonheur, c’est bien le grand Clint qui en hérita ! (Warner)
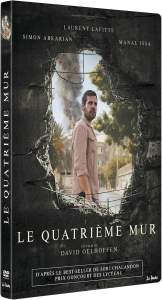 LE QUATRIEME MUR
LE QUATRIEME MUR
Dans le Liban de 1983, un taxi circule dans un paysage en ruines. A bord, Georges et Marwan, son chauffeur druze. Au loin, un vieux tank soviétique T55 se met à tirer. Des coups de feu partent de tous les côtés. Blessé à la jambe, Georges parvient à se mettre à l’abri… A Paris, l’année précédente, Georges est au chevet de son vieil ami Samuel Akounis. Cet artiste juif grec qui a perdu tous les siens à Birkenau, se meurt. Il fait promettre à Georges, qui fut son élève, de se rendre à Beyrouth pour mettre en scène Antigone, la pièce de Jean Anouilh, afin de voler un moment de paix au cœur d’un conflit fratricide. D’ailleurs, Sam a déjà trouvé, en Imane, la comédienne palestinienne qui sera Antigone. Les personnages seront interprétés par des acteurs venant de tous les camps politiques et religieux du Liban. Le projet est aussi utopique que risqué. Montrer que le théâtre est plus fort que la guerre en jouant dans une salle située précisément sur la ligne verte ou ligne de démarcation. Voler un moment de paix au cœur d’un conflit fratricide ! Même s’il a conscience de ne pas vraiment comprendre ce qui se joue dans le Liban de 1983, Georges accepte le défi, en l’occurrence « donner à des adversaires une chance de se parler en travaillant ensemble autour d’un projet commun ». Perdu dans une ville et un conflit qu’il ne connaît pas, Georges est guidé par Marwan mais la reprise des combats remet bientôt tout en question. Georges, qui est tombé amoureux d’Imane, va devoir faire face à la réalité de la guerre. Réalisateur notamment de Loin des hommes (2014) d’après la nouvelle L’exil et le royaume d’Albert Camus et Les derniers hommes (2023) tiré du roman Les chiens jaunes d’Alain Gandy, le réalisateur David Oelhoffen adapte, cette fois, le roman éponyme de Sorj Chalandon paru en 2013 chez Grasset et prix Goncourt des lycéens. Dans les suppléments du dvd, l’ancien reporter de guerre et journaliste à Libération, explique, dans un entretien avec le cinéaste, que son livre est né de la vision d’une jeune Palestinienne morte dans le camp de Sabra et Chatila. Une image qui l’a hanté très longtemps jusqu’à ce que la jeune morte devienne un personnage majeur du Quatrième mur. Au côté d’Imane, sa comédienne et son amante, Georges ira ainsi jusqu’au coeur de la guerre, en particulier dans ce camp, tragiquement célèbre, où Imane vit et enseigne, comme institutrice. Dans un propos qui a une dimension universelle (toutes les guerres se ressemblent), David Oelhoffen réussit à rendre palpable la tension constante qui règne dans le Liban du début des années 80 en suivant au plus près un artiste qui, dans un conflit inextricable, va se rendre compte de l’impossibilité de ce projet oecuménique de pièce de théâtre en plein conflit et se retrouver, littéralement, dévoré par la guerre. Comme les interprètes sont remarquables, en tête Laurent Lafitte (Georges), Simon Abkarian (Marwan) et Manal Issa (Imane), ce film prend vraiment aux tripes. (Le Pacte)
 LA CHAMBRE D’A CÔTÉ
LA CHAMBRE D’A CÔTÉ
A New York, Ingrid, un romancière réputée, dédicace son dernier ouvrage dans lequel elle tente d’exorciser sa peur de la mort. Une lointaine amie lui rapporte que Martha Hunt est très malade. Martha fut, il y a longtemps, l’une des amies les plus proches d’Ingrid. Celle-ci se précipite à l’hôpital où son amie est soignée pour un cancer en phase terminale. Au fil de rencontres régulières, les deux amies vont revenir sur ce qui faisait le sel de leurs existences et aussi évoquer le temps présent avec ce qu’il suppose de douleurs et de peurs, enfin la nécessité d’affronter la fin. Un jour, ayant pris la décision d’arrêter ses traitements, Martha propose à Ingrid de s’installer dans une belle maison à la campagne, à deux heures de route de Manhattan. Elle souhaite qu’Ingrid soit présente dans la chambre d’à côté lorsqu’elle mettra fin à ses jours en avalant une pilule d’euthanasie achetée illégalement. D’abord rétive à l’idée, Ingrid accepte… Premier long-métrage en anglais d’Almodovar, La chambre d’à côté est un mélodrame qu’on attendait comme on attend, depuis maintenant longtemps, tous les films du maître de la movida madrilène. Adaptant Quel est donc ton tourment, le roman de l’Américaine Sigrid Nunez, Almodovar observe au plus près une vieille amitié mise à l’épreuve de la mort. A travers de longues conversations, Martha et Ingrid vont faire un dernier bout de chemin ensemble, se révoltant de voir le cancer présenté comme une lutte entre le bien et le mal. Ces instants d’échange sont d’une remarquable intensité. D’autant que la diaphane Tilda Swinton comme Julianne Moore en amie désespérément troublée sont parfaites d’émotion. Pour cause de signature colorée un peu rapportée, pour cause de flash-back en rafale (ah, les deux frères carmes homosexuels professant que « le sexe est le meilleur rempart contre la peur de la mort »), on a le sentiment de s’éloigner de l’essentiel, en l’occurrence ces questionnements de Martha lorsqu’elle se sent « réduite à la portion congrue d’elle-même » ou qu’elle constate qu’« on n’est plus maître de soi lorsqu’on souffre ». Demeurent cependant des fulgurances comme ces images d’une neige rose tombant sur New York ou encore les derniers mots des Gens de Dublin de Joyce qui clôturent le film… (Pathé)
 PLANETE B
PLANETE B
Dans la France de 2039, la société et l’État sont complètement à la dérive. La jeunesse et notamment les activistes sont en ébullition. A Grenoble, un petit groupe d’éco-activistes font exploser deux bombes, visant à la fois une antenne et un dépôt de carburant. Traquée dans un immeuble abandonné, Julia Bombarth, une militante chevronnée appartenant au groupe La R, parvient à s’échapper en tuant accidentellement un policier. Mais le jeune bleu qui était avec elle, la jambe détruite, est laissé derrière. Tous ces activistes recherchés par la police disparaissent sans laisser de traces. Lorsque Julia sort de son sommeil, elle se découvre, enfermée, dans un monde totalement inconnu. Planète B est la première prison virtuelle… Après s’être fait remarquer, en 2019, avec Les héros ne meurent jamais, un premier long-métrage sur fond de conflit en Bosnie, la cinéaste Aude Léa Rapin se lance, ici, dans un film de genre qui n’est pas la tasse de thé habituelle du cinéma français, en l’occurrence la science-fiction. C’est parce qu’elle voulait justement tenter ce pari qu’Aude Léa Rapin s’est lancée dans cette entreprise, avec aussi le désir d’en donner une vision féministe. La cinéaste explique que l’idée du film est née de la vision d »une société en ébullition après les Gilets jaunes puis le Covid et d’un questionnement sur la démocratie et la peur de l’avenir proche. Si le propos politique est bien présent dans Planète B, le film, entre monde réel et monde virtuel, est aussi un thriller captivant et divertissant qui se donne des allures de Blade Runner pour son univers urbain sombre et glauque où se transportent des matières qu’on imagine toxiques et où une imposante base militaire ressemble à un terrifiant univers concentrationnaire. Mais la trouvaille d’Aude Léa Rapin est d’avoir imaginer sa prison virtuelle comme un univers paradisiaque et ensoleillé au bord de la mer. Les cellules sont d’agréables pièces à vivre (cependant dotées d’une mystérieuse et inquiétante chambre noire) et les prisonniers parcourent une nature exubérante ou se retrouvent sous des parasols autour d’une vaste piscine. Il n’empêche que les détenus demeurent constamment stressés de ne pas connaître le sort qui les attend. Dans sa prison « exotique », Julia, la militante écolo passée à l’action violente, va recevoir l’aide inattendue et précieuse de Nour, une journaliste irakienne réfugiée en France. Entourées d’un casting éclectique, Adèle Exarchopoulos et Souheila Yacoub campent deux battantes dans un univers à la dérive. (Le Pacte)
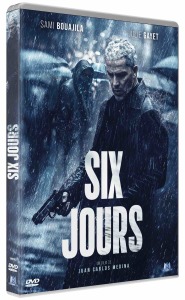 SIX JOURS
SIX JOURS
En septembre 2005, Malik Rezgui, un flic lillois, n’a pas réussi à empêcher la mort de la petite Chloé, victime d’un enlèvement. Le policier n’arrive pas à oublier cet échec d’autant que la mère de l’enfant, est toujours présente pour lui rappeler ce terrible ratage. Onze ans plus tard, le commandant Rezgui sait qu’il ne lui reste que six jours avant la prescription de ce crime non résolu. Malgré l’avis de sa hiérarchie et le scepticisme de son collègue et meilleur ami, il décide de se replonger, avec l’aide de la mère de Chloé, dans ce dossier. Sur les lieux du drame, il découvre, planté dans un piquet, une rose blanche. Mais la police lilloise est à nouveau sur les dents. Devant le domicile de sa mère et quasiment sous les yeux de son grand-père, la petite Louise est enlevée. Cette fois, c’est la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) qui est chargée de l’affaire. Le commandant Rezgui est prié d’aller jouer ailleurs. Mais le flic aussi fatigué que teigneux a déjà remarqué que le modus operandi des deux dossiers est exactement le même… On avait remarqué le cinéaste franco-américain Juan Carlos Medina d’abord, en 2012 avec le film fantastique catalan Insensibles puis, en 2016, avec un autre film de genre, d’horreur celui-là, intitulé Golem, le tueur de Londres où un détective de Scotland Yard bataillait, dans le Londres de 1880, avec Golem, monstre des légendes hébraïques d’Europe centrale. Depuis on avait perdu la trace du cinéaste, parti exercer ses talents dans les séries. Il est de retour, de surcroît en France, en l’occurrence du côté des espaces industriels de Dunkerque entre dunes et mer mais avec un remake d’un thriller coréen, Mong Ta-joo mis en scène par Cheung Keun-sup qui, semble-t-il n’est pas resté dans les mémoires. C’est en tout cas pour Médina l’occasion de renouer avec l’un de ses thèmes favoris, celui de l’enquête et de ses flics le plus souvent au fond du trou. Le fond du trou, ce sont déjà les ciels bas d’une ville battue par la pluie ou encore les vastes espaces de bord de mer plutôt sinistres sans oublier les hangars pourris et une vieille cabine téléphonique largement taguée… au temps des portables. Pour le reste, l’intrigue est parfois embrouillée et elle prête même à quelques invraisemblances. Pourtant, on suit volontiers Rezgui, ce flic sombre et taciturne qui n’arrive pas à se défaire des ombres d’une enquête ratée. Sami Bouajila est tout à fait crédible dans ce personnage hanté. Et il est bien entouré par Julie Gayet, Philippe Résimont, Anne Azoulay, Gilles Cohen, Marilyne Canto ou Manon Azem. (M6)
 MEMOIRES D’UN ESCARGOT
MEMOIRES D’UN ESCARGOT
En Australie, la jeune Grace Pudel est séparée de son frère jumeau à la mort de leur père. Placée dans une famille d’accueil gentille mais distante, et impuissante à venir en aide à son frère placé chez des religieux intégristes, la fillette se renferme sur sa passion pour la lecture et les escargots. Fort heureusement, elle se lie d’amitié avec Pinky, une vieille dame farfelue qui va lui redonner goût à la vie. Le cinéaste australien Adam Elliot avait été remarqué en 2009 à la sortie de Mary et Max, un film d’animation pour adultes en pâte à modeler autour de l’autisme, de la différence et de la solitude, qui avait été présenté au Festival Sundance et récompensé du Cristal du long métrage au Festival international du film d’animation d’Annecy. Avec Memoir of a Snail (en v.o.), le cinéaste et scénariste, qui peaufinait ce projet depuis une décennie, s’est inspiré de sa « vraie mère ». Au Festival d’Annecy 2024, il a, à nouveau, décroché le Cristal du long-métrage. Le réalisateur retravaille avec les mêmes dispositifs que pour son premier long, en l’occurrence une image sépia où la couleur se fait discrète, une prime donnée à la voix off et surtout un regard sur les misères de l’existence. Une fois encore, le film d’Adam Eliott s’éloigne radicalement du conte de fées. Point, ici, de mièvrerie mais une appréhension de la solitude et de l’isolement dans un univers qui part à vau-l’eau. Et on en vient à se dire que l’Australie n’est pas une terre hospitalière aux solitaires et aux abandonnés. Trois personnages perdus traversent ces images : Grace dont le sort n’est pas enviable, Pinky, la vieille dame au coeur brisé dont on sait vite qu’elle va disparaître et que dire du frère de Grace pris dans le piège familial d’une bande d’horribles fanatiques… Et pourtant, malgré l’éprouvante noirceur ambiante, Adam Elliot parvient à instiller un brin d’espoir dans son propos. (Wild Side)
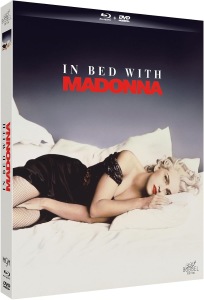 IN BED WITH MADONNA
IN BED WITH MADONNA
D’avril à août 1990, de Tokyo à Nice en passant par Munich, Toronto, Madrid, Chicago, Dallas, Rome, Londres, Barcelone, Philadelphie ou Osaka, le Blond Ambition Tour a été la troisième tournée (et la seconde tournée mondiale) de Madonna. Si les tournées The Virgin Tour et Who’s That Girl Tour étaient d’énormes entreprises, elles se déroulaient cependant comme des concerts de stades traditionnels. Le Blond Ambition Tour avait cette fois un thème : l’orchestre, l’élément central d’un concert en stade, serait repoussé à la marge pour permettre à la chanteuse et à ses danseurs de créer un spectacle de référence aux films Metropolis de Fritz Lang et Orange mécanique de Stanley Kubrick. A l’occasion du Blond Ambition, avec des extraits de concert enregistrés le 6 juillet 1990 au Palais omnisports de Paris-Bercy, le cinéaste Alek Keshishian s’est attelé à un documentaire qui promène ses caméras dans les coulisses du show, dévoilant l’intimité de la star aussi bien lors de ses concerts que dans le cadre de sa vie privée. Si le titre laisse entrevoir une certaine intimité, on passe cependant très peu de temps dans le lit de Madonna. Le documentaire offre un témoignage brut sur les coulisses de cette tournée légendaire. Afin d’obtenir des images aussi authentiques que possible, les caméras sont souvent dissimulées, les opérateurs se fondent dans le décor et n’ont pas le droit de s’adresser à Madonna ni à ses danseurs. Les extraits de concert sont filmés en couleurs, tandis que les scènes en coulisses sont en noir et blanc, renforçant ainsi l’opposition entre le spectacle et réalité. Le résultat est une plongée extraordinaire dans l’intimité de la star, révélant des moments de stress, de joie, de fatigue, mais aussi d’introspection et de vulnérabilité. Ce qui ne devait être au départ qu’une simple captation de concert est devenu tout autre chose. Alek Keshishian s’aperçoit rapidement que ce qui se passe en coulisses est tout aussi captivant que le spectacle sur scène, et qu’il y a matière à réaliser un film bien plus ambitieux. L’histoire lui donnera raison. In Bed with Madonna (pour la première fois en Blu-ray) sera une affaire très rentable ! À l’époque, avec cette tournée, la reine de la pop choque et fascine. Madonna mêle références religieuses et connotations sexuelles, allant jusqu’à simuler une masturbation sur scène, provocant ainsi un scandale international. A Toronto, la police menace même de l’arrêter pour obscénité. Mais au-delà de la controverse, elle propose un spectacle grandiose, avec une narration visuelle et thématique très travaillée, révolutionnant l’industrie du divertissement. Ses tenues, dont le légendaire corset à seins coniques, sont créées par Jean-Paul Gaultier, le célèbre styliste français réputé pour son anticonformisme. Madonna assume son image de femme libre et provocante, et s’impose comme une véritable prêtresse du spectacle. (PopBubbel Edition)
 LA PASSION SELON BEATRICE
LA PASSION SELON BEATRICE
En septembre 2022 , Béatrice Dalle arrive en Italie. A l’origine de ce voyage, il y a le désir de marcher dans les traces de Pier Paolo Pasolini, l’homme de sa vie (avec, dit-on, Jean Genet et Kurt Cobain). D’est en ouest, du nord au sud, la comédienne parcourt les décors de son rêve afin qu’advienne la rencontre. Poétique et mystique, ce documentaire mâtiné de road-movie, réalisé dans un beau noir et blanc, relate l’histoire de la quête de Béatrice Dalle. Entre documentaire et fiction, voici donc, plus qu’une quête de l’auteur de Mamma Roma, un portrait de Béatrice Dalle par le cinéaste belge Fabrice du Welz, centré autour de leur passion commune pour le cinéma et la figure de Pier Paolo Pasolini. La passion selon Béatrice (rien à voir avec La passion Béatrice de Bertrand Tavernier en 1987) dévoile une Béatrice Dalle inattendue, souvent douée d’un humour ravageur autant qu’à fleur de peau. L ‘actrice révélée en incontrôlable Betty dans le 37°2 le matin (1986) de Beineix, retrouve des lieux de tournage, croise d’anciens collaborateurs du cinéaste tragiquement disparu sur la plage d’Ostie en 1975. Le réalisateur du récent Dossier Maldoror voulait éviter de donner un documentaire littéral, préférant opter pour une narration hybride et hors des cadres communs. En quête de Pasolini, le film réunit deux univers émotionnellement forts et deux figures sans compromis : Béatrice Dalle et Pasolini lui-même dont la comédienne traduit l’image rêvée qu’elle s’est créée de lui. Ce cinéma aussi sophistiqué qu’authentique connaît de beaux temps forts comme cette projection à la Cinémathèque de Bologne de L’évangile selon Saint Matthieu où les larmes coulent sur les joues de l’actrice mais aussi d’autres assez insignifiants comme les retrouvailles avec Abel Ferrara qui dirigea « son » Pasolini en 2014 et filma, non sans moments houleux, Béatrice Dalle dans The Blackout (1997). En suppléments, on trouve Dévotion (26 mn), un entretien inédit avec Fabrice du Weltz qui observe : « Béatrice est révolutionnaire dans tous les choix de sa vie, elle a une intransigeance réelle, c’est un samouraï (…) J’y vois comme une sœur d’âme et de passion ». Les fans de l’actrice la plus punk du cinéma français devraient y trouver leur compte ! (Carlotta)
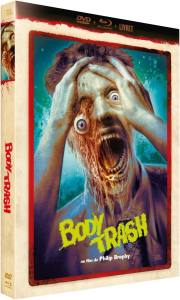 BODY TRASH
BODY TRASH
Les habitants de la paisible bourgade de Peebles Court dans la banlieue de Melbourne en Australie deviennent les cobayes d’un scientifique psychopathe qui les utilise pour tester secrètement sa nouvelle drogue de synthèse, la Vimuville. Ayant des effets bénéfiques au départ, les effets secondaires sont malheureusement plutôt catastrophiques. Après une phase d’hallucinations intenses, le produit provoque des ravages insoupçonnés : cordes vocales qui étouffent son propriétaire, placenta qui mange le fœtus d’une femme enceinte, corps qui fondent, explosion du pénis. Le chercheur ayant découvert la molécule, Brian Rand, a connaissance d’un précédent test, qui a conduit à la mort des sujets d’expérience. Tentant de prévenir les habitants contaminés, mais infecté lui-même à son insu par sa maîtresse et patronne Shaan qui veut couvrir la compagnie pharmaceutique, des tentacules lui sortent de la gorge et il a un accident mortel. L’inspecteur Sam Philipps et le sergent « Johnno » Johnson enquêtent et tentent de percer ce mystère… En 1993, le compositeur, réalisateur, scénariste et monteur australien Philip Brophy réalise, avec Body Melt (en v.o.) son premier et unique long-métrage qui mêle comédie et horreur gore. Comme il situe son récit dans le genre trash, le cinéaste peut s’en donner à coeur-joie dans les divagations les plus folles. On croise, ici, la gamine difforme d’une famille des plus dégénérée qui s’avère être une nymphomane cannibale ou encore un bodybuildeur sous stéroïdes qui parle avec la voix d’un enfant de cinq ans. Une série B qui ne craint pas le crade. (Rimini Editions)

